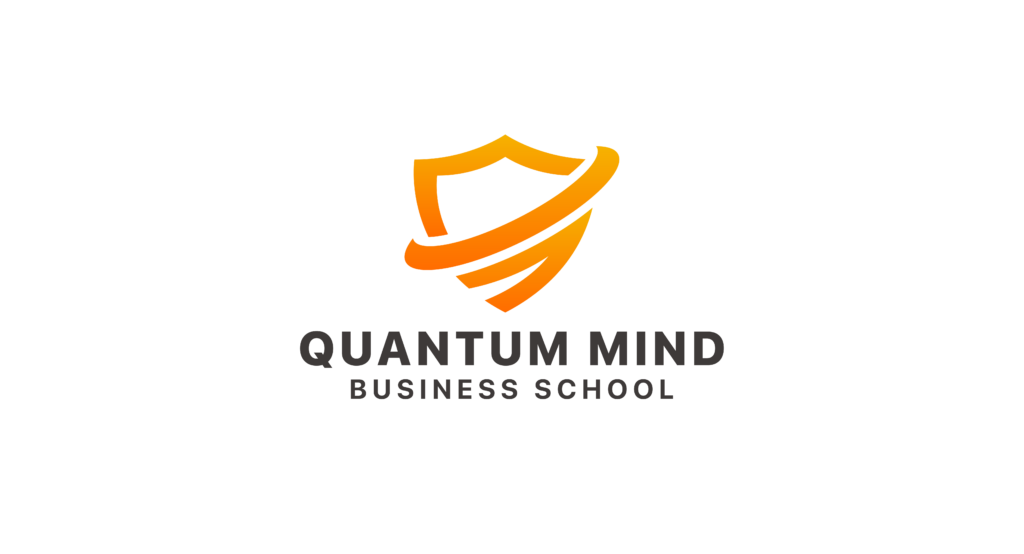« Renforcer l’attractivité des carrières scientifiques et l’investissement dans la recherche. » C’était l’un des quatre piliers du budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 2025. Mais malgré un montant de 89 millions d’euros supplémentaires annoncés – et déjà en suspens à cause de la censure – tous les maillons de la chaîne de santé s’accordent sur le fait que la France n’investit toujours pas assez.
En 2021, un état de la situation de la recherche en France dressait un premier bilan mitigé : « Avec 2,22% du PIB consacré à la recherche intérieure en 2021, la France est en deçà de l’objectif de 3% fixé par l’UE ». Surtout, la santé est, depuis 10 ans, le parent pauvre des allocations de l’enveloppe de recherche. Le pays consacre environ 17% à la recherche en biologie-santé, contre 35% à 40% pour les pays européens voisins et jusqu’à 50% pour le Royaume-Uni, d’après des chiffres de 2020 .
Malgré la pandémie de Covid, force est de constater que la ligne ne change pas beaucoup. Emmanuel Macron a pourtant lancé 16 nouveaux programmes en mai 2023 pour accélérer la recherche et l’innovation en santé dans le cadre de France 2030 et créé une agence de l’innovation fin 2022, mais cela ne vient que « se mettre au-dessus d’un mille-feuille complexe d’institutions de recherche » , regrette Frédéric Bizard, économiste de la santé.
Trop de bureaucratie
Car au-delà du problème de sous-financement chronique dont souffre la recherche en santé ces dernières années, la France se pénalise par sa bureaucratie. « On est constamment en train d’écrire pour obtenir des financements » , se désole Enzo Poirier, chercheur en immunologie à l’Institut Pasteur. La lenteur de l’administration se voit davantage dans les essais cliniques. La France se retrouve souvent derrière l’Espagne ou l’Allemagne, plus rapides à ouvrir des centres pour effectuer la continuité des recherches.
« Il y a aussi peu de relations entre la recherche publique et les start-up », explique Frédéric Bizard. « Il faut faire comme en Allemagne ou aux Etats-Unis et créer des clusters qui mêlent, sur un même lieu, de la recherche publique, des acteurs privés ainsi que des centres de formation ».
Le chercheur ajoute tout de même qu’ « il n’y a pas de volonté d’accélérer la recherche en santé en France, pour une raison qui m’échappe » . Et la réponse se trouve peut-être dans le parcours, très littéraire, des membres du gouvernement. C’est en tout cas ce qu’avait avancé Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de Chimie en 2020, dans un entretien au magazine l’Express . En Allemagne par exemple, plus de 3% du PIB était attribué à la recherche sous la houlette d’Angela Merkel, ancienne chancelière et scientifique de formation.
L’IA, nouvel espoir de compétitivité
« Nous avons un autre problème culturel. Le secteur de la santé pense que l’industrie et la recherche ne sont pas son souci », renchérit Frédéric Bizard. Ce dernier estime que la responsabilité n’est pas uniquement liée aux dirigeants, mais aussi à l’ensemble des acteurs de la santé qui ne collaborent pas suffisamment ensemble. La France regorge tout de même de très bonnes formations scientifiques, reconnues mondialement. Et le domaine qui émerge, tant au niveau du financement accordé par la France qu’à son potentiel d’utilisation, c’est l’Intelligence artificielle (IA).
Cette dernière capitalise une grande partie de l’attention du gouvernement en matière de financement et plusieurs projets sont déjà destinés au secteur de la santé afin d’améliorer l’efficience dans la recherche, et ainsi de faire baisser les coûts.
« Avant, le temps moyen de la découverte d’une nouvelle molécule jusqu’à la prise par le patient prenait autour de 10 à 15 ans. Avec l’IA, les étapes de recherches vont désormais deux fois plus vite » , nous confie Alan Russell, vice-président de la recherche chez Amgen, entreprise leader dans les biotechnologies.
Ce dernier estime qu’à l’avenir, il ne faudra que quelques mois entre la découverte et la mise à disposition d’un produit. Il se pourrait même que l’IA découvre la molécule d’intérêt par elle-même. Une perspective réjouissante dans le monde de la recherche, étroitement lié aux autres pans du secteur de la santé. « Les Centres hospitalier universitaire (CHU) sont en perte d’attractivité, car la recherche est aussi une source de motivation pour nombre de médecins que vous n’avez pas dans le secteur privé » , rappelle Frédéric Bizard. Pour rappel, 98% des hôpitaux publics connaissent des tensions sur le recrutement dans au moins une spécialité médicale, selon les derniers chiffres de la Fonction publique hospitalière.