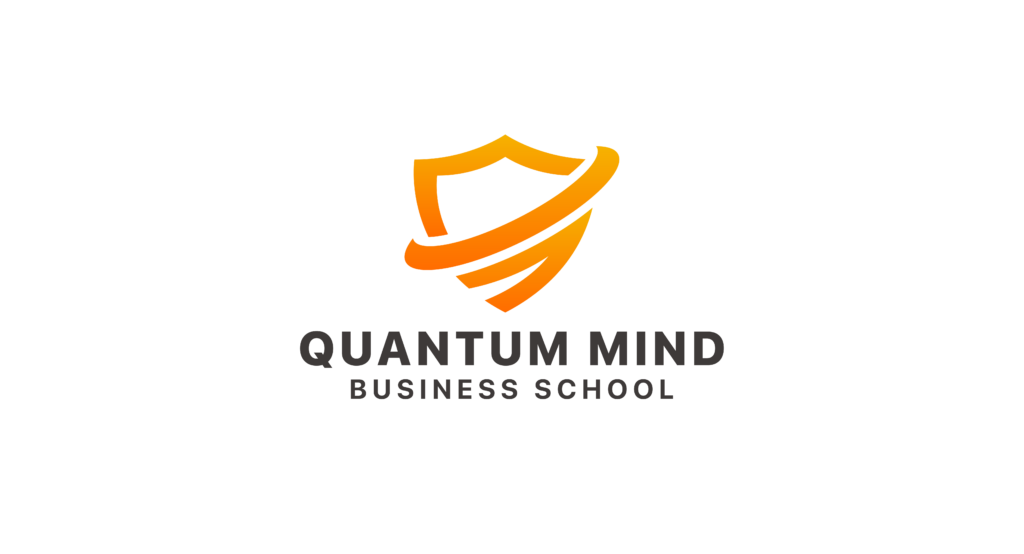Depuis près d’un demi-siècle, la réduction des dépenses publiques s’est imposée comme un principe directeur de la gouvernance économique française, transcendant les clivages politiques traditionnels. Cette obsession budgétaire, masquée derrière différentes rhétoriques selon les époques, révèle une transformation profonde et constante de notre modèle social et économique.
Une continuité politique au-delà des alternances
De la “commission de la hache” instaurée par le gouvernement Daladier en 1938 aux récentes déclarations de François Bayrou, en passant par les réformes de Raymond Barre (1976-1981), la volonté de “faire des économies” s’est progressivement établie comme un impératif catégorique des politiques publiques françaises.
Cette orientation budgétaire restrictive s’est imposée indépendamment des alternances électorales, suggérant une convergence idéologique sur les questions économiques qui dépasse les étiquettes partisanes traditionnelles. Si les méthodes et la rhétorique varient, l’objectif demeure identique : réduire le périmètre de l’intervention publique.
Des résultats économiques contradictoires
Paradoxalement, alors que les plans d’économies se sont succédé sans interruption, l’endettement public français a connu une progression spectaculaire, passant d’environ 30% à 110% du PIB en quatre décennies. Cette contradiction apparente s’explique notamment par l’érosion progressive des recettes fiscales, particulièrement celles provenant des contribuables les plus aisés et des grandes entreprises.
Plusieurs mesures emblématiques illustrent cette tendance : la réduction de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ramené de 50% après la Libération à 33% en 1993 puis à 25% en 2024 ; la création du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en 2012 ; et son remplacement en 2019 par une réduction globale des cotisations sociales représentant 100 milliards d’euros.
Une transformation discrète mais profonde de la société
Cette évolution s’est accompagnée d’une réduction significative du poids de la fonction publique dans l’économie nationale. Si 20% des actifs travaillaient en 1985 dans la fonction publique, représentant 13,5% du PIB, ils ne sont plus que 18% aujourd’hui (12% du PIB), avec une précarisation croissante puisqu’un quart d’entre eux sont désormais contractuels.
Les politiques économiques des dernières décennies se caractérisent ainsi par deux tendances majeures : la privatisation progressive des services publics et l’allègement continu de la fiscalité des entreprises, le tout sous la pression des critères budgétaires européens issus du traité de Maastricht.
Un langage politique aux intentions voilées
Derrière les dénonciations récurrentes de “l’étatisme”, du “fiscalisme”, des “charges” ou de la “bureaucratie” se dissimule un projet politique cohérent visant à remodeler profondément le contrat social français. La “simplification administrative”, présentée comme une mesure de bon sens, masque souvent une remise en question des normes sociales et environnementales.
Ce vocabulaire politique à double fond témoigne de l’importance de décrypter les intentions réelles qui sous-tendent les discours économiques contemporains. La compréhension des origines et des objectifs du projet néolibéral, dominant depuis plusieurs décennies, apparaît comme un préalable indispensable au débat démocratique sur l’avenir de notre modèle social.